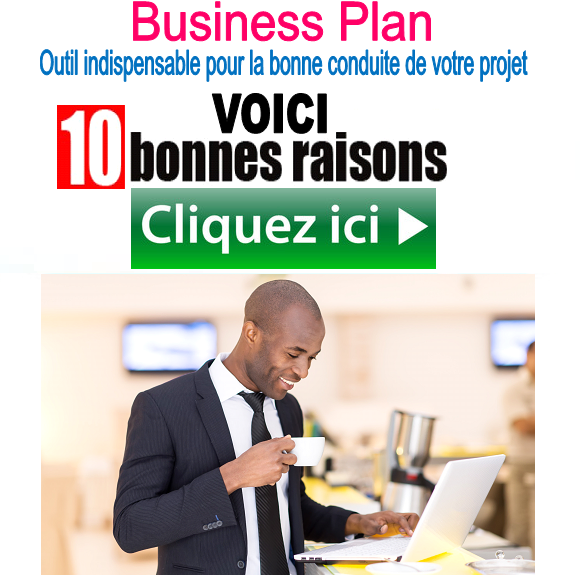Sur tout le continent, des entrepreneurs nouvelle génération fondent
des établissements haut de
gamme, souvent soutenus par des fonds
privés. Objectif : faire émerger les dirigeants de demain.
Et si les maux de l’Afrique étaient essentiellement liés à
un manque de leadership ? Des entrepreneurs d’un genre nouveau en sont
persuadés et se disent déterminés à faire émerger des dirigeants
capables de porter la transformation de toute l’économie africaine. Leur
stratégie ? Multiplier les universités haut de gamme pour former
l’élite du futur. « Je voudrais pouvoir imprégner les étudiants d’un
sens profond de l’engagement, tout en leur donnant des compétences pour
innover et entreprendre », affirme le Ghanéen Patrick Awuah.
Ex-manager de Microsoft, il en a démissionné pour créer
en 2002 l’université Ashesi dans la petite ville de Berekuso, à 30 km
d’Accra. Immenses salles de classe ultra-connectées, laboratoires
modernes, bibliothèque… un campus international à l’américaine dans un
paisible et luxuriant îlot de 40 hectares. Venus de l’ensemble du
continent et notamment du Kenya, du Rwanda, d’Afrique du Sud et du
Zimbabwe, ses quelque 900 étudiants doivent s’acquitter d’environ
9 000 dollars de frais de scolarité par an. Mais grâce à un partenariat
établi avec l’université, la fondation MasterCard prend en charge la
scolarité de plus de la moitié d’entre eux. « Ils contribueront à
l’amélioration du continent », parient les responsables de la fondation.
Modèle écoles de commerce
Bien qu’il valorise le modèle américain, Patrick Awuah mise
sur l’africanisation de son université. Son architecture s’inspire des
cours traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ; le nom de l’établissement
signifie « commencement », en akan, et son logo renvoie à des symboles
de cette culture. Elle propose six cursus différents de quatre ans, tels
que le management des systèmes d’information et les ingénieries
informatique, électrique et électronique ou encore mécanique.
Conçus comme les business games des écoles de
commerce occidentales, les cours se veulent participatifs. Par groupe de
six à dix, les étudiants choisissent une problématique à laquelle doit
faire face le Ghana. Ils ont ensuite deux semestres pour trouver des
solutions. Les projets sont présentés devant toute l’université, et les
quinze les plus aboutis sont transformés en entreprises grâce aux
soutiens de fondations partenaires. Patrick Awuah affirme que ses
étudiants ont un taux d’insertion professionnelle de 90 %, six mois
après l’obtention de leur diplôme.
Lauréat du Wise Prize for Education 2017, présenté comme le
Nobel du secteur, il voudrait désormais étendre le modèle à tout le
continent et milite pour une « panafricanisation » de l’éducation.
Depuis cinq ans, il multiplie les programmes d’échanges avec des
universités africaines. En 2017, il a invité une douzaine d’entre elles à
créer une plateforme collaborative commune.
6 000 candidatures
Autre Ghanéen piqué par ce virus de l’éducation nouvelle génération, Fred Swaniker, diplômé de la Stanford Business School, a créé l’African Leadership Academy (ALA),
un programme qui vise à encourager l’esprit entrepreneurial chez les
jeunes Africains. Créé en partenariat avec le Camerounais Acha Leke,
consultant du cabinet McKinsey, et deux amis, Peter Mombaur et Chris
Bradford, l’ALA a déjà accueilli plus de 700 étudiants à très fort
potentiel issus de tout le continent.
Mais son initiative la plus médiatisée reste l’African
Leadership University. Ses deux campus haut de gamme ont représenté
chacun un investissement de 100 millions de dollars. Considéré comme le
Harvard de l’Afrique, le premier, dirigé par Graça Machel, a ouvert à
Maurice en 2013 ; basé à Kigali, au Rwanda, le second est opérationnel
depuis septembre 2017. Ils accueillent chacun quelque 300 étudiants, en
provenance d’une trentaine de pays.
À l’horizon 2060, Fred Swaniker rêve de former 3 millions de leaders africains dans un réseau de 25 universités
Fred Swaniker dit avoir reçu chaque fois plus de
6 000 candidatures en provenance de 54 pays en moins de seize jours. Un
record, au regard du coût de la formation : 10 000 dollars annuels par
élève sur quatre ans. Mais l’université, qui se finance grâce à des
levées de fonds, prend en charge tout ou partie des frais de scolarité.
En échange, les élèves s’engagent à lui reverser entre 2 et 10 % de leur
future rémunération pendant dix ans. « Un bon compromis, quand on sait
que la durée d’un prêt étudiant – quand on en obtient un – peut excéder
vingt ans », estime Fred Swaniker.
Confidentiel. À l’horizon 2060, il rêve de former 3 millions
de leaders africains dans un réseau de 25 universités (pour un coût
global de 2,5 milliards de dollars). Il mise aussi sur le recrutement de
25 % de ses effectifs hors du continent, pour des frais de scolarité
compris entre 20 000 et 24 000 dollars annuels.
Fondations
Certains étudiants voient leur cursus – sur le continent ou
ailleurs – financés par de généreux mécènes au travers de fondations.
Pionnier en la matière, Nelson Mandela a parrainé en 2002 une initiative
du Rhodes Trust. Ce fonds a alors donné 10 millions de livres sterling
(environ 15 millions d’euros) à la Fondation Mandela Rhodes. Depuis
2005, une vingtaine d’étudiants, essentiellement sud-africains et
zimbabwéens, sont entièrement pris en charge pour suivre un programme
d’exception d’une année.
Le cursus, qui se veut lui aussi panafricain mais reste
confidentiel, repose sur quatre grands thèmes : leadership,
entrepreneuriat, réconciliation et éducation. Les étudiants se
rencontrent lors de retraites informelles avant la rentrée, puis
repartent en milieu d’année pour des bosberaad (« conférences en brousse ») à travers le pays. Il s’agit d’échanger sans stress sur des questions de haute importance.
L’Anglo-Soudanais Mo Ibrahim entend lui aussi créer une pépinière de futurs leaders africains en finançant un programme de bourses de leadership. Très
sélectif, il offre aux heureux élus l’occasion de se former au plus
haut niveau dans des institutions africaines comme la BAD ou des
organismes multilatéraux ayant pour vocation d’améliorer les
perspectives économiques et sociales de l’Afrique.
Université Panafricaine
L’Union africaine (UA) fait aussi le pari d’une éducation haut de gamme avec son Université panafricaine (UPA).
En lien avec les problématiques régionales, ses programmes sont
destinés à former des cadres de haut niveau dans des organismes de
développement. Elle compte cinq pôles dans les cinq régions du
continent : sciences de la gouvernance et de l’intégration régionale en
Afrique centrale (Cameroun), informatique et mathématiques en Afrique de
l’Est (Kenya), sciences de la terre et de l’agriculture en Afrique de
l’Ouest (Nigeria), sciences minières en Afrique du Nord (Algérie),
sciences spatiales, à venir, en Afrique australe.
Chaque promotion compte quelque 70 étudiants, rigoureusement
sélectionnés à Bac +3 dans les 54 États africains. Mais près de 15 %
des étudiants enregistrés sont originaires des pays hôtes. Au Cameroun,
par exemple, parmi les 58 élèves de la deuxième promotion, 15 sont des
locaux. Formés pour intégrer l’UA, ils comptent parmi leurs enseignants
des experts qui ont fait leurs preuves dans le management des
institutions internationales, et même des Premiers ministres.
Chaque mois, ils perçoivent une allocation comprise entre
750 et 1 100 dollars. Mais le coût de la formation, entièrement pris en
charge par l’UA et ses partenaires suédois ou japonais, est tenu secret.
Agir à la racine
Le financier camerounais Cyrille Nkontchou, fondateur du
groupe Enko Education, fait partie de ceux qui estiment que pour faire
émerger des profils africains de qualité, compétitifs à l’international,
il faut agir en amont. Présent au Cameroun, en Afrique du Sud, au
Mozambique, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, son réseau panafricain de
huit établissements du secondaire a pour vocation de permettre aux
élèves d’intégrer les meilleures universités au monde, grâce à leur
baccalauréat international (BI), pour des coûts de formation compris
entre 2 000 et 4 000 dollars annuels.
Formés à Yaoundé, quelques-uns des douze premiers bacheliers
d’Enko ont pu intégrer Yale, l’Imperial College de Londres ou encore
les universités canadiennes de Toronto et de la Colombie britannique à
la rentrée 2017.
Source: Jeune Afrique