
« Le Monde Afrique » publie les bonnes feuilles du livre de son
chroniqueur Samir Abdelkrim, qui
retrace trois ans de pérégrinations
dans les start-up du continent.
Samir Abdelkrim a décidé, un jour de 2014, qu’il fallait explorer
l’Afrique numérique. Pas derrière son écran, mais dans les incubateurs
de start-up, les accélérateurs ou les espaces de coworking, de Nairobi à
Lagos, de Dakar à Kigali. Le Monde Afrique a publié une
quarantaine de ses chroniques de terrain avec ces dizaines de milliers
de jeunes qui s’engagent pour réparer leurs pays et voient dans le
numérique une opportunité d’agir, de créer, de s’élever. De ses
pérégrinations dans la scène tech de plus de 20 pays africains, Samir
Abdelkrim a tiré un livre, Startup Lions, au cœur de l’African Tech,
262 pages, publié sur Amazon. Nous publions en bonnes feuilles une
partie de l’introduction, qui raconte sa rencontre à Dakar avec Malick
Birane, 22 ans, l’inventeur d’une application mobile pour aider les
pêcheurs sénégalais à mieux vendre leur poisson.
Le quotidien d’un entrepreneur africain
Dakar,
place de l’indépendance. Il fait très chaud. Depuis l’aube, le soleil
cogne sur la ville. Je plonge dans le premier taxi pour fuir les
embouteillages qui coagulent autour de moi. Il est 16 heures et c’est
déjà la sortie des administrations dans le quartier du Plateau. Au
milieu de la sueur et du tintamarre de la circulation, le vieux tacot
arrive à rejoindre la corniche sans trop d’encombres.
Nous
mettons le cap sur le port de Soumbédioune. C’est une simple crique où
les pirogues à moteur échouent à même le sable. Au bout d’une dizaine de
minutes, le taxi s’immobilise en tressautant devant un jeune homme qui
attend là (…). « Mon rendez-vous précédent se trouvait
juste à côté. Je viens de faire le point avec un grand restaurant de
fruits de mer sur la corniche. » Malick est un jeune entrepreneur
de 22 ans. Ce qui interpelle chez lui, c’est l’intensité et la
détermination qui brillent dans son regard de geek. Soudain, il se
retourne, sourire en coin : « Tu arrives à Dakar au bon moment. Nous
avons validé notre modèle économique et venons tout juste de sortir la
nouvelle version de notre plateforme. Je vais te montrer comment notre
solution fonctionne ! »
Malick Birane est le
fondateur d’une start-up qu’il a baptisée Aywajieune, ce qui signifie en
wolof « je vends du poisson ». Je laisse l’entrepreneur me guider dans
ce qu’il appelle son espace de travail à ciel ouvert : le grand marché
aux poissons de Soumbédioune qui, du temps de sa splendeur, nourrissait
tout Dakar. Une dizaine de pirogues à moteur viennent de rentrer au
port. Chaque équipage utilise de vieux pneus usés pour caler sur le
sable sa gaal, ou pirogue en wolof. Commencent alors les
négociations entre pêcheurs et mareyeurs (pour la plupart des femmes)
venus s’approvisionner en gros. Les poissons les plus variés – thons,
badèches, sars et même quelques beaux mérous blancs – sont déchargés sur
le sable. C’est à partir de cette anse exiguë que, chaque matin,
plusieurs centaines de pirogues traditionnelles partent en quête de
poissons dans un mouvement d’ensemble bariolé. Ils ravitaillent les
marchés de la capitale, mais aussi exportent.
« Le poisson, c’est un peu le pétrole du Sénégal et le pain de chaque Sénégalais, m’explique Malick. Nos poissons sont exportés vers l’Europe, mais ils constituent la base de nos plats, à commencer par le thiéboudienne. » Le thiéboudienne est le plat national de Sénégal. Au pays de la teranga (hospitalité), le poisson, thiof en
wolof, est chose sacrée. Les Sénégalais mangent en moyenne 30 kg de
poisson par habitant et par an. Le secteur ferait vivre plus de deux
millions de personnes, si l’on compte les familles des pêcheurs.
Eviter les intermédiaires
Avant
même que je l’interroge, le jeune « disrupteur » se lance dans un pitch
bien calibré et me décrit le douloureux problème qu’il tente de hacker (résoudre).
« Les pêcheurs sénégalais sont financièrement étranglés. Ils manquent
d’informations sur les prix de vente des poissons et se font souvent
avoir sur les montants en les écoulant. » J’essaie de suivre la
fine silhouette du jeune entrepreneur qui se faufile au milieu des étals
de poissons posés directement sur le sable. Malick ralentit un court
instant pour saluer un jeune pêcheur. Celui-ci porte un bonnet blanc à
rayures noires sur la tête, son pantalon sombre est recouvert de sable
humide. Ils semblent tous deux avoir le même âge. Malick poursuit : « Les
pêcheurs rencontrent par ailleurs des difficultés à entrer directement
en contact avec les consommateurs finaux, restaurateurs et particuliers.
Il y a trop d’intermédiaires qui font écran. » Tablette tactile
sous le bras, Malick Birane rend visite chaque semaine aux pêcheurs pour
prendre de leurs nouvelles. Au milieu de ce décor où tout n’est que
marchandage et va-et-vient, il collecte les feedbacks de ses
utilisateurs. Ces retours sont importants, ils lui permettent
d’améliorer son service et de s’assurer qu’il résout bien leurs
problèmes spécifiques. (…) Les trois quarts lui déclarent
écouler leurs poissons au rabais, sans réaliser de profits. Ils bradent
des bassines entières de rougets, de barracudas, de soles, pour éviter
les invendus.
Lorsqu’ils sont ruinés, les pêcheurs cherchent à émigrer vers l’Europe avec leur pirogue. Une minorité sombrera même dans le trafic de vies humaines en devenant passeurs.
Beaucoup aimeraient
pourtant vendre directement aux particuliers, augmenter leurs marges et
élargir leurs débouchés. Il faudrait pour cela des moyens logistiques
qu’ils n’ont pas. Plusieurs ont déjà confié leur désarroi au fondateur
d’Aywajieune : « On a moins de prises, donc normalement les prix
devraient augmenter. Mais on est mal organisés. Certains jours, les prix
sont tellement bas qu’on essaie de garder le poisson le plus longtemps
possible pour le vendre à un bon prix. Et finalement on ne vend pas et
on doit tout jeter. » Cette situation représente pour Malick Birane une véritable injustice : « Le secteur de la pêche est très dynamique au Sénégal et génère d’énormes profits. » Malheureusement, « les pêcheurs à l’origine de cette création de valeur ne parviennent pas à en vivre dignement ».
Pour
la pêche à la palangre, les hommes sont souvent contraints de naviguer à
plus de 10 kilomètres du rivage pour trouver du poisson dans les
profondeurs. Le jeune Sénégalais connaît le désespoir qui fige le regard
fatigué des travailleurs de la mer, les jours où le poisson déserte le
littoral. Sans doute du fait de la pollution, mais aussi du pillage des
chalutiers battant pavillon étranger. Ces navires-usines s’aventurent en
hiver dans les eaux territoriales sénégalaises pour siphonner les fonds
poissonneux en toute illégalité. Les dépenses en « essence pirogue »
grimpent en flèche, car les pêcheurs doivent s’éloigner toujours plus
loin, aggravant jour après jour le manque à gagner (…). « Lorsqu’ils sont ruinés, les pêcheurs basculent dans la pauvreté ou cherchent à émigrer vers l’Europe avec leur pirogue. »
Une minorité sombrera même dans le trafic de vies humaines en devenant
passeurs. En 2006, d’importants accords de pêche entre le Sénégal et
l’Union européenne ne sont pas renouvelés. Alors que la crise
halieutique atteint son paroxysme à Dakar, des centaines de pêcheurs
sénégalais débarquent plus de 30 000 migrants africains sur les plages
des îles Canaries. Parmi eux, combien ne sont pas arrivés à destination,
leurs frêles esquifs ayant chaviré sous les vents puissants de
l’Atlantique ?
Amas luisant de poulpes entrelacés
Malick
scrute un petit attroupement de badauds et de pêcheurs qui encerclent
une pirogue. Elle vient de s’échouer sur le sable, le ventre encore
frétillant de la pêche du jour. Au moment où nous tournons les talons,
un pêcheur d’une trentaine d’années surgit de la foule pour venir à
notre rencontre, avec un grand sourire. « Grand, comment va le business ? »,
s’exclame Malick qui le reconnaît aussitôt. Fervent utilisateur
d’Aywajieune, Samba navigue au large de Dakar depuis plus de 10 ans pour
nourrir ses parents, sa femme et ses deux enfants. Il apprécie beaucoup
Malick Birane depuis qu’un matin, alors qu’il rinçait son moteur à
l’eau douce, le jeune entrepreneur est venu le convaincre d’utiliser son
application.
Les très bonnes semaines, le chiffre d’affaires peut même tripler. Les poissons bradés à vil prix ne sont plus qu’un lointain souvenir…
Samba
nous emmène devant son étal gargantuesque où gît un amas luisant de
magnifiques poulpes entrelacés. Grâce à Aywajieune, ils régaleront ce
soir les plus grandes tables de la capitale. La marchandise a déjà
trouvé trois acquéreurs offrant chacun un excellent prix. Parmi les
acheteurs figure un particulier résidant dans le quartier du Plateau. En
plein essor, les ménages de la classe moyenne dakaroise représentent
désormais un gros tiers des commandes passées sur Aywajieune. Deux
livreurs de la start-up doivent d’ailleurs arriver d’un moment à l’autre
pour charger et transporter les belles prises de Samba. Depuis qu’il a
rejoint la plateforme, ses revenus ont en moyenne doublé. Les très
bonnes semaines, le chiffre d’affaires peut même tripler. Les poissons
bradés à vil prix ne sont plus qu’un lointain souvenir… Grâce à
Aywajieune, Samba est visible sur Internet et assure quotidiennement des
débouchés à ses poissons.
Chaque
jour que le jeune pêcheur regagne la terre ferme avec sa cargaison, il
accomplit le même rituel. Avec son smartphone à bas prix prêté par un
neveu, il prend en photo les poissons frais rincés et posés
soigneusement dans une bassine en plastique. Il charge ensuite, toujours
avec son portable, les images sur Aywajieune. Il décrit le produit puis
précise la quantité et le prix du jour au kilo en francs CFA. Il
indique enfin son numéro de téléphone en bas du formulaire en ligne. Une
vingtaine de minutes plus tard, Samba reçoit les premiers appels et SMS
des restaurateurs de la capitale, qui se dépêchent de passer commande
pour réserver les plus beaux morceaux.
Solution vocale pour pêcheurs illettrés
Les
livreurs arrivent enfin. Malick leur rappelle qu’ils ne doivent pas
oublier de charger au passage les poissons d’Ousmane, un autre pêcheur
Aywajieune, dont l’étal se trouve quelques dizaines de mètres plus loin.
Un peu plus âgé que Samba, Ousmane vend également sur Internet depuis
quelques mois, mais contrairement à lui, « il n’a pas fait les bancs »,
m’explique Malick. Autrement dit, il ne sait ni lire ni écrire. Ousmane
met donc chaque jour en ligne ses poissons « par la voix ». Il appelle
directement le service commercial d’Aywajieune qui va remplir et publier
les annonces à sa place. « Notre service commercial reçoit tous les jours des appels de dizaines de pêcheurs illettrés, précise Malick. Nous les aidons à vendre leurs poissons sur Internet. »
Sur l’étal d’Ousmane, trois caisses de maquereaux, chinchards et
crevettes gisant sur un lit de glace sont prêtes à être expédiées. Elles
sont destinées aux restaurants du quartier branché de la pointe des
Almadies. Les restaurateurs régleront les coursiers en espèces, à la
livraison.
En
Afrique de l’Ouest, la très grande majorité des commerçants n’est pas
« bancarisée », ce qui rend les paiements en ligne ou par carte bancaire
encore peu courants. Peu importe, la start-up enjambe vite l’obstacle.
Grâce à la technique si africaine du cash on delivery, le
paiement d’un produit acheté sur Internet peut se faire en espèces au
moment de la livraison. Aywajieune transférera ensuite les montants dus à
Ousmane et Samba sur leur téléphone portable grâce au paiement mobile –
rapide, facile, sécurisé. Du débarquement des poissons à leur livraison
au client, l’efficacité redoutable d’Aywajieune permet d’éviter les
multiples embûches et points de friction logistiques.
Le numérique pallie en partie le manque d’infrastructures, avec un effet immédiat sur les bénéfices des pêcheurs. « Pour
eux, la vitesse de rotation des stocks de poissons est dorénavant
beaucoup plus rapide. Elle est passée de 5 jours en moyenne à
24 heures. »
A Dakar, comme ailleurs en Afrique,
l’innovation est nécessaire pour répondre aux problèmes du quotidien. Le
téléphone portable fait ici office d’ordinateur, de carte bancaire et
de mégaphone pour cette vente à la criée numérique. Des centaines de
clients comblés par les services d’Aywajieune partagent régulièrement
leur satisfaction sur les réseaux sociaux. Ce bouche-à-oreille 2.0
représente aujourd’hui le plus gros canal d’acquisition pour la start-up
de Malick Birane. Il m’explique comment les pêcheurs et leurs clients
sont devenus les premiers ambassadeurs d’Aywajieune, grâce au buzz
qu’ils font sur Facebook. Pour se rémunérer et payer les salaires, la
société perçoit sur chaque transaction une commission correspondant aux
services de mise en relation et de livraison. La petite entreprise
innovante de Malick Birane a créé une quinzaine d’emplois (…).
« Personne ne te financera, tu n’as aucune relation ! »
Pour
Aywajieune, la voie vers le succès fut tout sauf facile. Chaque jour,
il fallait repartir à l’offensive sur le terrain pour expliquer et
convaincre. Plusieurs pêcheurs, n’ayant jamais utilisé Internet de leur
vie, ne cachaient pas leur méfiance. (…) La patience finit par
payer : au bout de quelques mois, plus de 100 pêcheurs utilisent
Aywajieune au quotidien, à Soumbédioune puis au Quai de pêche de Hann.
Et grâce au bouche-à-oreille, bientôt dans les ports de pêche de
Saint-Louis, l’autre grande ville du Sénégal.
Le numérique africain est une fabrique d’inclusion sociale et les entrepreneurs sont les tisserands d’une Toile à visage humain, des rivages de Soumbédioune aux villages isolés du Sahel, en passant par les mégapoles de Nairobi ou Lagos.
Ce n’est
pas au milieu des pirogues de Soumbédioune que Malick Birane s’est vu
opposer les refus les plus cinglants. Comme la plupart des entrepreneurs
de son âge, il a dû affronter le mépris des hommes d’affaires et des
banquiers, cravatés dans leurs bureaux climatisés et leur entre-soi.
« Pour qui tu te prends ? Tu crois que c’est sage de créer une
entreprise à 21 ans ? Personne ne te financera, tu n’as aucune
relation ! Et tes parents, ils sont au courant ?… Et ils te laissent
faire ? » Mais Malick Birane ne lâche rien, bien au contraire. Plus
on doute de lui, plus il croit à l’importance de sa mission. Et les
pêcheurs sénégalais seront toujours là pour la lui rappeler.
« Avec Aywajieune, me dit-il,
les poissons les plus demandés peuvent rapporter jusqu’à 1 million de
francs CFA, contre 300 000 francs CFA en moyenne auparavant. » Pour
ses pêcheurs que Malick admire et respecte, il y a donc un avant et un
après Aywajieune. Mais l’impact de la start-up dépasse le simple
bénéfice économique. L’idéal de Malick serait de changer la vie de ces
pêcheurs. Beaucoup tentent encore de quitter le Sénégal en pirogue pour
rejoindre l’Union européenne. Il en connaît même un qui a renoncé à
partir depuis qu’il utilise Aywajieune. (…) Quand maintenant il
prend la mer avec sa pirogue, c’est pour revenir avec du poisson et non
pour s’exiler au péril de sa vie. C’est la plus grande fierté de
Malick.
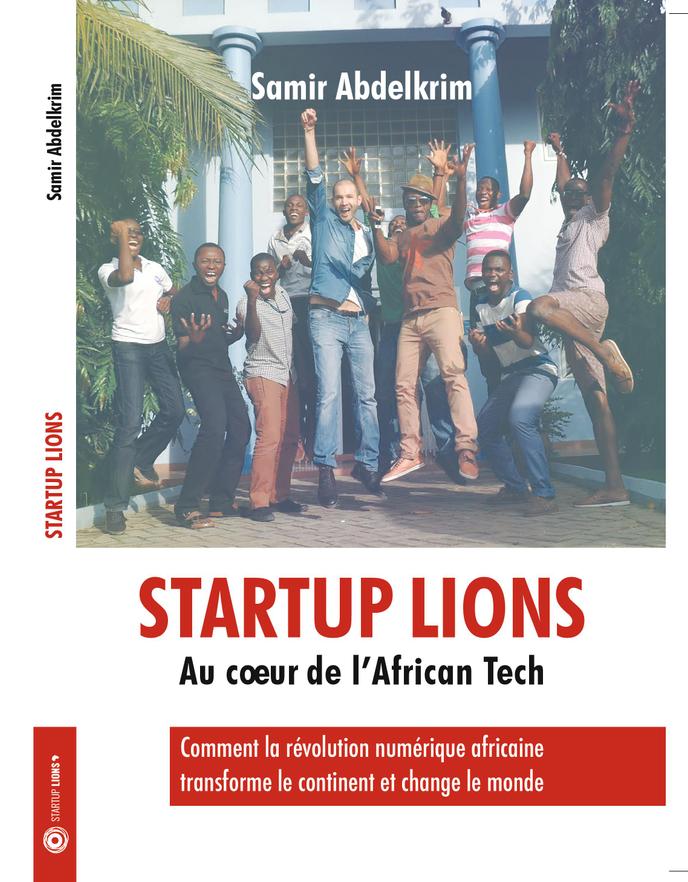
Et si c’était en Afrique que notre futur s’inventait déjà ? Ce livre (…) espère
répondre à cette question. Il est le fruit d’un long et patient travail
de terrain qui a débuté sur le continent africain en 2014. Je suis allé
à la rencontre des écosystèmes numériques locaux dans le cadre de mon
projet TECHAfrique. J’ai sillonné pendant plus de deux ans les routes en
construction de la tech africaine au cours d’un passionnant road trip entrepreneurial. Il m’a conduit au centre de la révolution start-up, qui se répand de Dakar à Cotonou en passant par les makerspaces de
Lomé et d’Abidjan ; des compétitions entrepreneuriales d’Accra et de
Johannesburg aux tech hubs qui fleurissent en Tunisie ou au Burkina
Faso.
Exploration sans relâche
Des
hauts plateaux éthiopiens aux collines de Kigali, j’ai exploré sans
relâche les scènes tech de plus de 20 pays africains. J’y ai rencontré
des centaines d’entrepreneurs qui ont partagé avec moi leur vision. J’ai
eu la chance de les suivre dans leurs incubateurs, accélérateurs ou
espaces de coworking. J’ai chroniqué leur quotidien dans
plusieurs centaines d’articles, publiés sur mes blogs comme dans les
médias nationaux et internationaux. C’est cette aventure au long cours
que je vous transmets avec Startup Lions, un livre qui vous
emmènera à la découverte de celles et ceux qui ont décidé par eux-mêmes
de transformer leur continent. A l’image d’Aywajieune, des centaines de
start-up africaines se révoltent contre le status quo, la pauvreté et
l’absence d’infrastructures. Ce n’est pas une tendance, c’est une
mission. Prendre des risques, hacker les difficultés du quotidien et innover pour pallier le manque de services publics.
Ces
entrepreneurs offrent l’image d’une jeunesse africaine qui se prend en
main et agit sans attendre. Ce qui les motive, c’est de trouver des
solutions aux problèmes de leurs pays, conquérir de nouveaux possibles,
changer le monde des hommes grâce au pouvoir des bits. Comme Malick
Birane, ces lions sont jeunes, pacifiques, déterminés. Ils sont des
dizaines de milliers à s’engager pour réparer leurs pays. Ils voient
dans le numérique une opportunité d’agir, de créer, de s’élever.
Certains soulèvent toutefois un problème : les start-up africaines
voudraient remplacer l’action publique et même l’aide au développement.
Ce n’est pas le cas.
Tout ce qu’elles veulent, c’est
accélérer le développement de l’Afrique à tous les niveaux et permettre
aux femmes et aux hommes qui la peuplent de vivre une vie décente. Le
numérique africain est une fabrique d’inclusion sociale et les
entrepreneurs sont les tisserands d’une Toile à visage humain, des
rivages de Soumbédioune aux villages isolés du Sahel, en passant par les
mégapoles de Nairobi ou Lagos.
Samir Abdelkrim, entrepreneur et consultant avec StartupBRICS. com, un blog sur l’innovation dans les pays émergents, est chroniqueur technologies pour le Monde Afrique.
Depuis 2014, il a parcouru une vingtaine d’écosystèmes start-up
africains et en a tiré un livre, désormais en vente sur Amazon en format
imprimé et numérique (Kindle).





