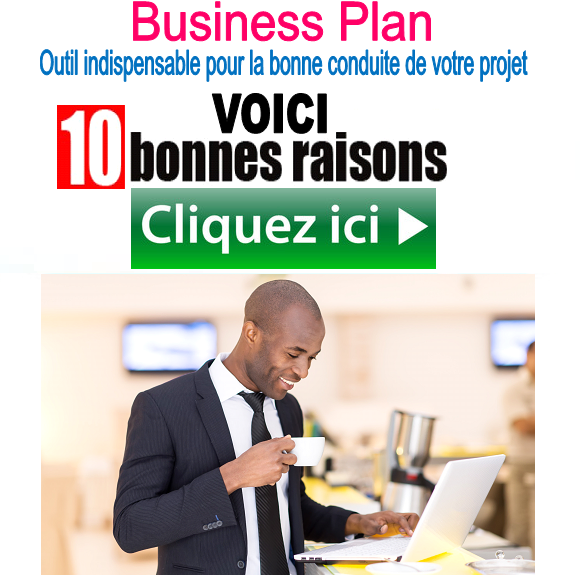Pour le ministre congolais de l'Économie, les États africains
doivent s’atteler à bâtir de vraies
économies compétitives, plutôt que
de se préoccuper de disposer chacun de sa monnaie. Ce qui ne l'empêche
pas de suggérer des évolutions dans la politique monétaire de la zone
CFA, notamment le passage de la fixité par rapport à l'euro à une
flexibilité contrôlée.
Depuis plus d’un an, il ne se passe plus un jour sans que
les Africains de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
et de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac)
ne parlent du franc CFA. Ils le font sous toutes les coutures : mauvaise
monnaie, cause des déconvenues économiques, bonne monnaie, garante de
la stabilité macro-financière, monnaie aux relents coloniaux, monnaie
d’avenir malgré tout, etc.
Ces échanges vifs dénotent, à tout le moins, de l’intérêt
qu’ils accordent au devenir économique de leurs pays. Cependant, on peut
déplorer le fait que mal ordonné, le débat va dans tous les sens, et on
en vient à se demander quel est le vrai sujet qui mérite débat.
Il nous semble opportun de revenir à l’économie et de limiter le débat à trois questions que nous jugeons fondamentales :
- chaque pays d’Afrique a-t-il intérêt à créer et à gérer en toute indépendance sa propre monnaie ?
- une monnaie autre que le franc CFA fera-t-elle le développement des pays qui se trouvent aujourd’hui dans la zone franc ?
- quel régime de change adopter ? Parité fixe ou libre fluctuation ?
1. La monnaie n’est pas à envisager comme l’expression de la souveraineté nationale
La souveraineté d’un pays ne se juge pas à sa monnaie. Une
nation, une communauté de personnes sur un territoire, peut disposer
d’une monnaie qui lui est propre, sans être souveraine pour autant. A
contrario, une nation peut partager une monnaie avec d’autres, sans en
avoir le contrôle, et en même temps, disposer des capacités à décider et
à agir seule dans plusieurs domaines qui lui confèrent une certaine
souveraineté.
La République démocratique du Congo,
qui a sa monnaie, n’est pas plus souveraine que la France qui a une
monnaie commune. L’inverse est tout aussi vrai. Les États-Unis
d’Amérique, avec leur dollar, ne sont pas moins souverains que la
République fédérale d’Allemagne, qui a l’euro en partage avec dix-huit
autres pays.
À l’ère de la mondialisation, vouloir une monnaie propre pour affirmer sa souveraineté nationale relève du non-sens
À sa naissance, la monnaie n’a jamais été associée à la
considération de souveraineté. L’histoire nous enseigne plutôt que les
principales fonctions attribuées à la monnaie ont été et demeurent :
- l’intermédiaire des échanges : la monnaie sert à payer les biens et services mis en vente
- l’unité de compte : la monnaie joue le rôle d’étalon de la valeur des biens et services échangés
- la réserve de valeur : la monnaie constitue un pouvoir d’achat que l’on peut accumuler pour en faire usage plus tard
De l’antiquité au début des temps modernes, ne pouvaient
être utilisés comme monnaie que des objets universellement acceptés en
paiement de biens ou de services. On est loin des considérations de
souveraineté nationale.
C’est dans ce même esprit universaliste qu’est né le nouveau
système monétaire international, consécutif à la conférence de Bretton
Woods de juillet 1944, reposant sur l’or comme monnaie de référence
internationale, « le Gold Exchange Standard ».
Toutes les monnaies nationales se définissaient alors par
rapport à l’or. Il n’y avait nullement de préoccupation de souveraineté
nationale en matière monétaire. Aujourd’hui, à l’ère de la grande
mondialisation des échanges, vouloir une monnaie propre pour affirmer la
souveraineté nationale relève simplement du non-sens.
2. Une monnaie autre que le franc CFA ne fait pas le développement
Pour preuve, la Guinée (en 1960), le Mali (de 1962 à 1984),
Madagascar (en 1972) et la Mauritanie (en 1973) qui avaient quitté la
zone franc pour émettre leur propre monnaie, ne sont pas, à ce jour,
plus développés que la plupart des pays de la zone franc. Outre le Mali,
qui est revenu dans la zone en 1984, la Guinée équatoriale (en 1985) et
la Guinée-Bissau (en 1997) ont rejoint la zone franc, préférant ainsi,
pour leur développement, la monnaie commune à la monnaie nationale.
Les pays africains qui s’étaient dotés de leur propre
monnaie et ont une politique monétaire depuis la première année de leur
indépendance, ne sont pas développés aujourd’hui. Plus de cinquante ans
se sont déjà écoulés. De toute l’Afrique, il n’y a que l’Afrique du Sud,
avec l’histoire qui est la sienne, qui siège au G20, le groupe des pays les plus développés du monde.
Ce sont les bonnes ou les mauvaises règles de gestion de la monnaie qui importent. Pas la monnaie elle-même, encore moins son autorité de tutelle
Les faits relevés à travers le temps tendent à montrer que
la majorité des pays africains émettant chacun leur monnaie ont souvent
connu une forte inflation et une déstabilisation de leur système
financier national. Face à la chute continue du cours de leur
monnaie, beaucoup n’ont pas hésité à changer la monnaie ou l’appellation
de celle-ci, tentant ainsi de la réévaluer artificiellement.
La politique monétaire fait partie intégrante des politiques
économiques, mais seule, elle ne fait ni le développement, ni le
sous-développement. À la vérité, pour un bon accompagnement du
développement ou non, il n’y a que de bonnes ou mauvaises règles de
gestion de la monnaie qui importent. Pas la monnaie elle-même, encore
moins son autorité de tutelle.
Si pour le franc CFA, c’est la définition des règles de
gestion convenues avec la France qui pose problème, il suffit,
devrait-on dire, d’un simple dialogue entre les autorités concernées,
pour que soit réglé le problème. Il n’y a pas besoin de débat
interminable sur le sujet.
3. Oui à la flexibilité contrôlée et non au libre flottement du franc CFA
De tout temps, les hommes ont eu tendance à rechercher la
stabilité du cours de leur monnaie. À Bretton Woods en 1944, par
exemple, les pères fondateurs du système monétaire d’après-guerre
visaient, entre autres, une stabilité monétaire internationale pérenne.
Chacun des 44 pays signataires des accords prenait l’engagement de
maintenir sa monnaie, pour une durée indéterminée, dans une fourchette
de valeurs proche de celle de l’or. Et le taux de change entre monnaies
de différents pays était fixe.
Même avec la fin en 1971 de l’accord de Bretton Woods et les
nouveaux accords de Kingston (Jamaïque) de 1976, les pays membres du
Fonds monétaire international s’étaient engagés à promouvoir un système
de taux de change stable.
Nombre d’économistes pensent que le fait pour les États-Unis
d’Amérique de laisser flotter librement leur monnaie, depuis août 1971,
connaissant des fortes variations – du simple au double – à la baisse
ou à la hausse, serait à l’origine de plusieurs crises économiques à
travers le monde. On attribue la crise économique de 1973 à la forte
baisse du dollar et celle de 1998, en Asie, à la forte hausse du même
dollar.
Il y a de bonnes raisons de se plaindre de la fixité du franc CFA par rapport à l’euro
Partant de ce vécu international, on ne peut qu’être enclin à préférer la stabilité du franc CFA à son libre flottement.
La stabilité n’exclut pas la flexibilité contrôlée. Il y a
de bonnes raisons de se plaindre de la fixité du franc CFA par rapport à
l’euro. D’où la nécessité de préconiser des marges encadrées de
flexibilité, permettant des ajustements ad hoc du franc CFA. Cela
pourrait être un ajustement à la baisse de 5 à 15 %, pour rendre plus
compétitifs les produits des pays de la zone franc vendus en Europe, ou
encore à la hausse dans les mêmes proportions, en vue d’alléger le coût
des importations en provenance d’Europe.
La Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et
la Banque des États d’Afrique centrale (BEAC) se verraient confier la
mission de déterminer les marges de flexibilité et jugeraient de
l’opportunité de les appliquer, dans un sens ou dans un autre, dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire.
Il faut avant tout avoir une vraie économie, solide, bien structurée et compétitive
L’économiste Jean-Baptiste Say avait dit, en 1803, « la
monnaie n’est qu’un voile », parce qu’elle ne fait que faciliter les
transactions sans incidence réelle sur le fonctionnement de l’économie.
Les économistes dits keynésiens lui avaient répondu, plus d’un siècle
après, que des variations monétaires entraînaient, à travers des taux
d’intérêt, des variations de l’investissement et donc de la production
et de l’emploi. Aujourd’hui, cela nous semble juste.
La monnaie n’est pas neutre par rapport à l’économie.
Cependant, pour disposer d’une bonne monnaie qui influence positivement
l’économie, il faut avant tout avoir une vraie économie, solide, bien
structurée et compétitive.
Les États africains doivent donc s’atteler à bâtir de vraies
économies compétitives, à les fortifier en les diversifiant chaque jour
un peu plus, plutôt que de se préoccuper de disposer chacun, d’une
monnaie.
Source: Jeune Afrique